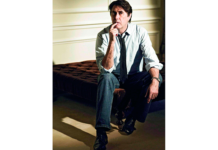L’actrice hollywoodienne Rose Byrne a déclenché une conversation vitale sur un aspect rarement reconnu de la parentalité : l’ambivalence, l’ennui, voire le regret, qu’éprouvent certaines mères. Dans une récente interview accordée au New York Times, Byrne a évoqué la pression sociétale exercée sur les femmes pour qu’elles acceptent la maternité sans condition, notant à quel point la simple suggestion selon laquelle une femme pourrait ne pas vouloir d’enfants semble menaçante. Il ne s’agit pas de détester les enfants, il s’agit de reconnaître que la maternité n’est pas universellement épanouissante et d’admettre ouvertement que cela est souvent tabou.
La pression de pratiquer la maternité
Les commentaires de Byrne s’alignent sur une tendance croissante d’artistes et d’écrivains explorant le côté le plus sombre et moins romancé de la parentalité. Sheila Heti, auteur de Motherhood, fait écho à ce sentiment, observant que les femmes qui expriment leur insatisfaction à l’égard de la maternité sont souvent qualifiées de « monstres ». L’industrie cinématographique commence à refléter cette réalité : le nouveau rôle de Byrne dans Si j’avais des jambes, je te donnerais un coup de pied dépeint une mère aux prises avec les exigences écrasantes de s’occuper d’un enfant malade. L’inspiration du film – l’expérience de la réalisatrice Mary Bronstein qui a dû faire face à la maladie de sa fille tout en se sentant perdue et dépassée – met en évidence le contraste saisissant entre la version idéalisée de la maternité et la réalité désordonnée.
Le travail invisible de la maternité
Ce qui rend le commentaire de Byrne si résonnant, c’est sa reconnaissance de la maternité comme une tâche épuisante et sans fin. S’attendre à ce que le corps d’une femme puisse gérer les exigences physiques liées à l’éducation des enfants ne signifie pas qu’elle soit préparée mentalement ou émotionnellement à cette responsabilité incessante. Cette fracture est encore exacerbée par le manque de soutien sociétal envers les mères, obligeant nombre d’entre elles à se sentir isolées et invisibles. Comme le note Byrne, « les mères sont à la fois vénérées et ignorées », une dualité qui perpétue la honte autour de toute émotion autre que la joie pure.
Pourquoi c’est important
Pendant des années, les conversations sur la maternité ont été dominées par des images idylliques de mères souriantes et de bébés chérubins. Ce silence a créé un mythe dangereux : selon lequel toutes les femmes devraient naturellement adorer être mères, et admettre le contraire est un échec moral. La volonté de Byrne de briser ce silence est importante car elle reconnaît que la maternité n’est pas une expérience universelle. Cela ouvre un espace pour des discussions honnêtes sur le fardeau mental et émotionnel de la parentalité, réduisant potentiellement la stigmatisation et encourageant davantage de femmes à demander de l’aide lorsqu’elles éprouvent des difficultés.
En fin de compte, la conversation entre Byrne et Heti est cruciale. La maternité n’est pas toujours facile, et admettre que cela ne fait pas de quelqu’un un mauvais parent, cela en fait un être humain.